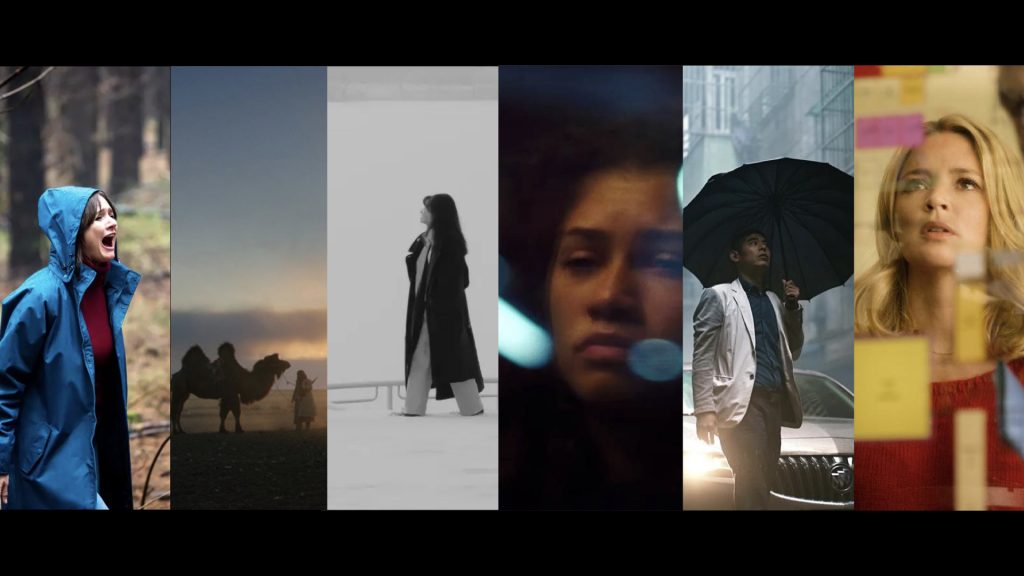
Relic, Natalie Erika James

Premier long-métrage d’horreur de la réalisatrice Natalie Erika James, dont les courts-métrages Creswick (2017) et Drum Wave (2018) avait déjà été salués dans de nombreux festivals, Relic est un chef d’œuvre d’angoisse et d’équilibre.
A partir d’un pitch simple, celui de la disparition d’Edna, une veuve septuagénaire, c’est l’histoire d’un corps et d’un esprit malade qui nous est racontée. Parties à sa recherche, sa fille Kay et sa petite-fille Sam s’installent chez elle pour attendre son retour. Elles enquêtent, explorent la maison couverte de post-it et de tâches qui semblent prendre vie sur les murs, et organisent des battues dans les bois qui ne révèlent rien d’autre qu’une étendue infinie d’arbres et d’obscurité.
Un plan large sur la maison, emprisonnée au milieu de ces bois, revient avec obstination tout au long du film. Il se fait interlude à l’angoisse intérieure, pause pour les personnages, et respiration pour un spectateur oppressé sans répit. Son calme étrange, qui ne laisse rien soupçonner des horreurs qu’il cache, en devient suspect et laisse envisager le pire. Il a aussi valeur d’écho métaphorique à un regard porté sur Edna, qui dissimule sa sénilité grandissante jusqu’à un point de non retour. Quand plus rien ne sépare la raison de la folie, que le corps est monstre, la maison se tranforme et embrase les pertes d’Edna, devient un espace poisseux et labyrinthique, donne lieu à une course poursuite des plus angoissantes où l’espace se resserre et se distord jusqu’à l’horreur.
Mettant en scène trois protagonistes femmes, la grand-mère, la mère et la fille – par ailleurs loin d’être réduites à leurs fonctions familiales – Relic offre aussi une une réflexion sur la représentation de la femme. Sans jamais la réduire à un genre social comme l’atteste l’oscillante masculinité de Sam, le film regarde avec justesse des problématiques qui lui sont spécifiques. La question du vieillissement du corps, s’il est source de l’horrifique du film, est aussi regardée avec sincérité et bienveillance, sans jugement. Ce n’est plus le fait de vieillir qui est monstrueux, mais bien le regard que l’on pose sur les corps abîmés et les esprits fragmentés.
Blandine Cecconi
Séjour dans les monts Fuchun/Et vogue le cinéma : La révélation Gu Xiaogang

Un mois avant l’ébullition magnifique d’Uncut Gems, l’année 2020 s’ouvrait dans le calme avec le beau Séjour dans les monts Fuchun, premier long-métrage de Gu Xiaogang. Dans le calme mais dans une douceur seulement apparente : derrière la chronique familiale empathique, patiemment filmée par une caméra aux mouvements caressants, se dissimule un film qui montre les mutations brutales des villes chinoises, celles de la province du Zhejiang ici, mais aussi comment l’argent, dont les personnages manquent le plus souvent, régit les relations humaines (Uncut Gems n’est finalement pas si loin).
Personnages que l’on retrouve dans Et vogue le cinéma, court-métrage réalisé par Gu Xiaogang au sortir du confinement et disponible sur Youtube. Dans les premières minutes du film, ce qui frappe est que rien ne semble avoir changé depuis Séjour dans les monts Fuchun : mêmes thématiques, même goût du plan séquence où, de manière très picturale, ce qui se joue à l’arrière-plan a au moins autant d’importance que ce qui se passe au premier… et pas la moindre allusion, donc, à la Covid-19. Il était question dans le premier film du cinéaste du passage du temps, au rythme des saisons, mais le temps, dans cette deuxième œuvre, semble s’être arrêté.
Aux deux-tiers du film, un basculement s’opère sans prévenir, et le titre fellinien se justifie alors : un bateau, sur lequel est placé un écran géant, dérive dans la nuit sur le paisible fleuve Fuchun. Gu Xiaogang s’attache, comme dans son premier long-métrage, à montrer que la nature est immuable, contrairement aux constructions humaines. Pas besoin de mots, une image suffit pour dire le propos : au temps du coronavirus, plutôt que se confiner dans les salles obscures, allons au cinéma dans la nature ! Le principe n’est pas nouveau (pensons aux drive-in) ; ce qui l’est, c’est le caractère ambulant du lieu-cinéma. Le bateau vogue bientôt vers la ville, où l’attendent les façades des immeubles, autres sources lumineuses éclairant la nuit. Mais il bifurque finalement, poursuivant sa balade solitaire jusqu’à quitter le champ, nous laissant dans les ultimes secondes face aux seules lumières de la ville.
Ce geste têtu est touchant : il dit que l’art ne doit pas se confondre avec le business. Mais il est aussi désespérant : le septième art, exilé, est menacé de ne plus être vu ailleurs que chez soi… Puisque l’heure est déjà aux vœux en prévision de l’année prochaine, souhaitons ardemment qu’en 2021, ce soit le cinéma qui revienne chez lui. Dans les salles obscures.
Lilian Anthoine-Milhomme
Hotel by the River, Hong Sang-Soo

Les myriades silencieuses,
Les océans infinis où les fleuves se déversent,
Les innombrables identités singulières et libres, comme la vue,
D’autres réalités vraies qu’eidolons.
Walt Whitman
Dans une année 2020 désertique, Hong Sang-Soo pousse à l’admiration. Il nous emmène dans un non-lieu poétique, un hôtel perdu au milieu de la neige, espace de rencontres et de retrouvailles où se mêlent un poète, ses enfants, une femme abandonnée et son amie. Encore une fois, le cinéaste fait preuve d’une économie de moyens peu commune dans le cinéma contemporain. Hong Sang-Soo comme un éternel amateur, adepte du plan fixe, du plan long et du regard minutieux. Ce qui étonne ici, c’est l’absence d’artificialité. Tout peut paraître artificiel dans la manière qu’a le cinéaste d’observer ses personnages (zooms visibles, musique qui intervient brusquement, etc.), mais rien ne sonne faux. La composition musicale de Dalpalan confère à certains plans une dimension tragique, en fait des espace troubles, étrangement humains. La dernière fois qu’une composition musicale avait aussi précisément joué avec l’image, c’était en 2015, dans Vers l’autre rive de Kiyoshi Kurosawa. La logique était la même : quelques notes faisaient irruption dans le film et venaient apaiser les corps et les regards pour les emmener ailleurs, impossible de savoir où, vers ce lieu hors du temps que nous appelons trop souvent et maladroitement poésie.
L’hôtel de Hong Sang-Soo est difficile à décrire, aussi opaque que les rapports humains. C’est pourquoi il s’agit de l’observer en plans fixes, en attendant qu’un geste survienne pour déclencher une émotion quelconque. Des fumées de cigarettes, des discussions dans des bars, un homme connu, que les autres reconnaissent mais qui ne se connait pas, une femme au téléphone assise sur un lit, ces éléments convergent avec tranquillité vers un édifice qu’ils auront tous participé à construire. Et l’hôtel se ferme sur des visages désormais familiers, attachés à tout ce que le spectateur a vu. Il serait dommage de passer à côté de la rivière sans vivre cette expérience intime.
Simon Pesenti
La Femme des steppes, le flic et l’oeuf, Quanan Wang

Le cinéma a soufflé le 28 décembre 2020 sur ses 53 bougies, concluant par cette anniversaire une triste année, qui a vu les salles se fermer sur des durées inédites depuis cent vingt-cinq ans.
Quel film retenir de l’année qui s’achève ? Il peut sembler judicieux d’en choisir un qui serait le reflet des déboires de l’année, et par cette périphrase je ne désigne pas seulement la Covid-19, mais aussi la montée des complotismes, ou la survivance du sexisme, entre autres. Borat Subsequent Moviefilm (de Sacha Baron Cohen) serait alors le film idéal, le miroir ironique de la réalité de 2020.
Mais je préfère retenir de cette année le pouvoir d’échappée du cinéma. Echappée qui n’a souvent rien d’onirique, même si elle nous permet de nous éloigner de nos vies, et de nos confinements : elle est plutôt géographique et sociale, on ne peut plus terre-à-terre.
Dans La femme des steppes, le flic et l’œuf, projeté les salles françaises en août dernier, il s’agit justement d’une terre, celle de la Mongolie, et du lien que les hommes et les femmes y entretiennent avec elle. Bien loin de toute mondialisation, là où les avions dans le ciel sont des tâches qui séparent le ciel en deux, se découvre un autre rapport à la terre sur laquelle ils naissent, sur laquelle ils se couchent, et dans laquelle ils retourneront.
Est mis en avant une vie qui n’est qu’un passage éphémère, un grain de poussière dans un monde immémoriel. Une vie naturelle et animale, à laquelle l’homme appartient dans la naissance, la reproduction et la mort. Cette animalité n’est pas négative ; c’est de là que découle la beauté de la vie, et de là que découle la beauté du film : de la terre, la nature, et l’animalité.
Joachim Laurent
Euphoria S1 E9 « Trouble Don’t Last Always », Sam Levinson : Rue is using again

Tout commence par un fantasme. Celui de Rue Benett, la jeune femme toxicomane au centre d’Euphoria. Ce fantasme, c’est celui du corps quasiment nu de Jules, parcouru par les baisers de Rue. Ce fantasme, c’est celui d’un couple parfait, qui s’aime à en crever. Puis Jules quitte le cocon rêvé par Rue, qui en profite alors pour récupérer des cachetons, les réduire en poussière et se les injecter par voie nasale. Le huitième épisode d’Euphoria terminait de façon lyrique sur cette réalité, et le neuvième, diffusé un an et demi après, la confirme dès son introduction : Rue is using again. La jeune femme ne sort pas de la salle de bain de son fantasme, mais des toilettes d’un drive-in, et va rejoindre Ali, son parrain aux narcotiques anonymes. Le lieu de l’action est posé : on ne quittera ni le restaurant ni les personnages avant le générique de fin. S’ensuit alors une longue discussion de près d’une heure entre l’adolescente et son mentor. Elle souhaite se droguer jusqu’à en mourir ; lui veut qu’elle redevienne sobre, comme lorsque tout semblait parfait avec Jules.
Sobre. Ce mot à lui seul peut résumer cet épisode spécial. Pas de voix off, pas de mouvements de caméra audacieux, pas de plan-séquence compliqué, pas de maquillage sophistiqué… Non, Sam Levinson se concentre ici sur cette discussion qui parle de la vie, de la mort, de Dieu, de la drogue, du pardon, du fait d’être une merde, en jouant simplement sur des variations d’angles de caméra dans son jeu de champ/contre-champ. Cette volonté d’épure se répercute dans la construction de l’épisode, qui peut se découper de façon scolaire : fantasme d’introduction, première discussion entre Ali et Rue, entracte musicale, apostrophe d’un personnage tierce par Ali pour relancer la discussion, départ du drive-in. Volonté d’épure qui se prolonge aussi dans le jeu des acteurs, qui n’amplifient pas leurs mots par de quelconques envolées lyriques ou des gestes grandiloquents comme si leurs corps étaient possédés par la puissance d’un texte ambitieux. Non. Ils discutent simplement. Elle est blasée, défoncée et déprimée ; lui essaie d’être là pour elle. Au mieux, une larme coule simplement le long de leurs joues. C’est suffisant.
L’épisode n’est pas sans lourdeurs, notamment cette reprise bancale d’Avé Maria qui suit le départ du restaurant, et le lent zoom sur le visage de Rue. Certains trouveront même que ce qui y est dit est vu et revu, voire moralisateur. Mais pour d’autres, ces mots résonneront plus profondément, au point d’éclipser les défauts de cet épisode, et de les emporter, comme la larme de Rue se laisse emporter par la gravité.
Lucas Martin
Adieu les cons, Albert Dupontel

Le dernier film d’Albert Dupontel fait partie de ceux qui restent en mémoire après son visionnage, s’apprécient au fil du temps, un peu comme on affectionne un souvenir. Souvenir qui, lorsqu’on y repense, semble de prime abord joyeux, baigné par la douce lumière d’une chaude soirée d’été, mais qui, lorsque certains détails reviennent, prend plutôt un aspect dramatique, laisse une impression douce-amère. Après un acte désespéré et une rencontre fortuite, JB (Albert Dupontel), un expert en cyber-sécurité, accepte d’aider Suze (Virginie Efira), coiffeuse en fin de vie qui cherche à retrouver son enfant, né sous X, pour donner un sens à son existence. Ce que parvient à retranscrire Dupontel, c’est le caractère anarchique d’une succession de coïncidences qui n’a pas de sens prédéterminé, sur lesquels les individus ont une emprise toute relative.
Par la saturation des couleurs, l’artificialité des lumières mises en place, la netteté de l’image, Adieu les cons présente une réalité esthétiquement sublimée, contrebalancée par des événements sombres. On pense au cinéma de Jean-Pierre Jeunet et notamment à Micmacs à tire-larigot (2009) dans lequel un groupe en marge de la société, dont ils n’attendent plus rien et qui n’attend rien d’eux, parvient à dénoncer des multinationales véreuses. On y retrouve le même genre de palettes chromatiques allant du rouge vif au jaune safran, avec des noirs bouchés. On peut reprocher aux deux cinéastes leur attirance pour les filtres aux teintes sépias, voire exagérément jaunes, mais cette référence au polaroïd, chez Jeunet puis Dupontel, n’est pas anodine. Dans Adieu les cons, la modernité, les avancées technologiques, la complexification administrative côtoient le vintage, l’ancien. Cette alliance de l’ancien et du moderne via l’étalonnage des couleurs trouve un écho supplémentaire dans la représentation des souvenirs heureux de Suze : un flashback dans lequel elle danse à 15 ans sur Mala vida de Manu Chao (1988). L’esthétique de cette scène évoque le grain épais caractéristique des vieilles cassettes vidéo. La mémoire est traduite visuellement : elle est mémoire du personnage en même temps que mémoire des médias de l’image. Cela renvoie aussi à la question de l’archive, à la conservation des supports, des savoirs-faire et des savoirs-être dont la perte engendre progressivement une amnésie culturelle et sociale que Dupontel dénonce. Ainsi, même si l’expert en cybersécurité arrive sans difficulté à récupérer des données numériques sur n’importe quel individu, l’accent est mis à plusieurs reprises sur la nécessaire existence de documents papiers (des archives, ou du journal d’un médecin). Cette résistance du monde physique face au tout numérique se traduit dans la matière même du film : le virtuel y est, dans une optique optimiste, envisagé dans le film comme une extension du réel, et non pas comme son remplacement.
Dans le même ordre d’idée, Adieu les cons dénonce la détérioration croissante de la capacité d’écoute. Les cons sont toutes les personnes qui ne savent pas écouter et qui, à force d’appliquer des protocoles ou des conventions sociales, ne réfléchissent plus à ce qu’être au monde signifie. L’égo a la part belle dans le film, pour ses bons mais aussi ses mauvais côtés. Le médecin qui annonce à Suze Trapet qu’elle a un cancer incurable au tout début du film semble lutter pour dissimuler son embarras, par rapport à la mauvaise nouvelle qu’il doit annoncer, mais également une certaine indifférence, dont il est difficile de savoir s’il en a conscience lui-même (en témoignent les nombreuses fois où il écorche le nom de sa patiente). Les présentations des personnages de Dupontel et Efira se font écho : tous deux font face à une autorité (médecin ou patron) qui tente de cacher sa gêne derrière une façade bienveillante mais finit par s’enliser dans les contradictions d’un discours trop bien rodé, excluant toute improvisation. Une mauvaise nouvelle annoncée avec le sourire restera mauvaise. L’argument avancé dans la scène de la consultation médicale de Suze et celle de l’entretien professionnel de JB afin de présenter les choses sous un aspect moins sombre est le même : la subjectivité du point de vue. Mais Suze va mourir, JB être écarté d’un projet dont il a réalisé la partie la plus importante, et cette réalité semble incontestable.
Chez Dupontel comme chez Jeunet, les personnages inadaptés à la société vont alors en transgresser les règles grâce à des atouts insoupçonnés et peu réalistes qui font basculer ces récits dans une certaine logique, celle des contes de fées. Dans les contrées merveilleuses qui nous sont dépeintes, l’apparition d’une menace choque particulièrement. La progression dramatique étonne, car on s’attendrait à ce que cette réalité esthétiquement augmentée soit le cadre d’existences sans heurts ni malheurs, et que les événements dépeints suivent une progression logique, régulière, au sein de laquelle le bonheur des personnages irait croissant. Mais il y a dans les films de Dupontel une rage polymorphe. Qu’il s’agisse d’un élan de vie, d’un irrépressible besoin de révolte ou même d’une bestialité latente, prête à surgir n’importe quand, cette rage est dans Adieu les cons l’apanage d’une humanité empreinte de carnavalesque et de jeux enfantins.
Etienne de Rivaz

